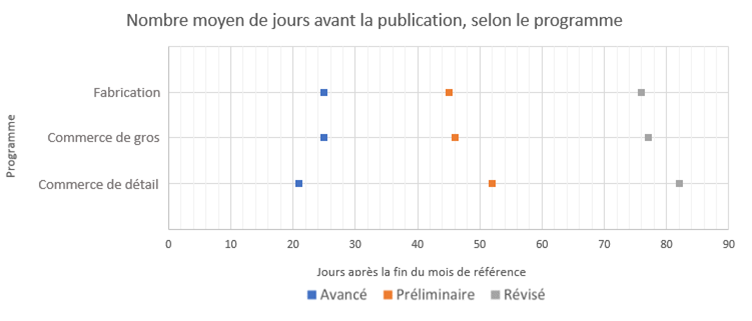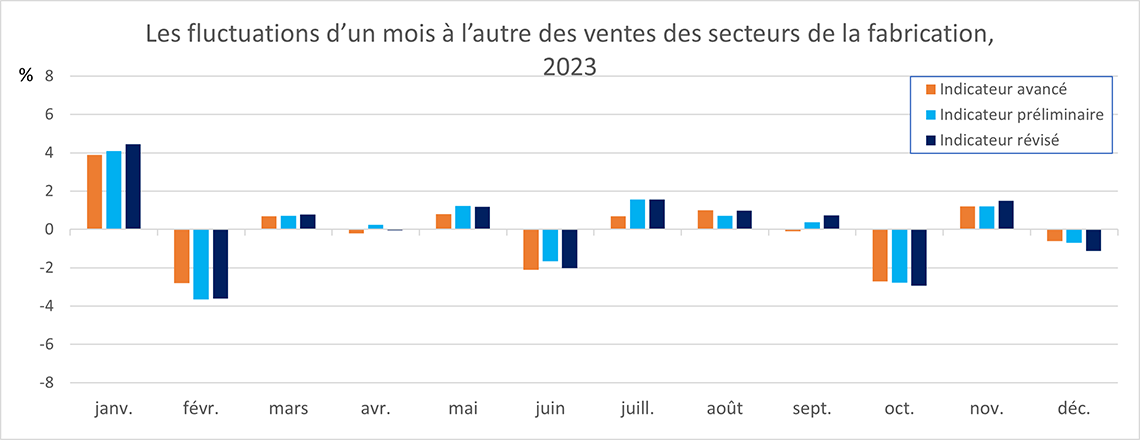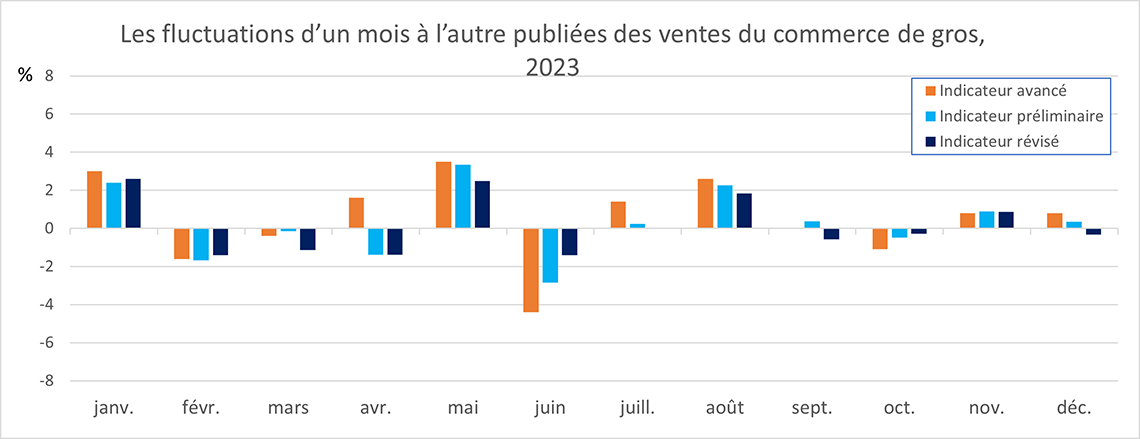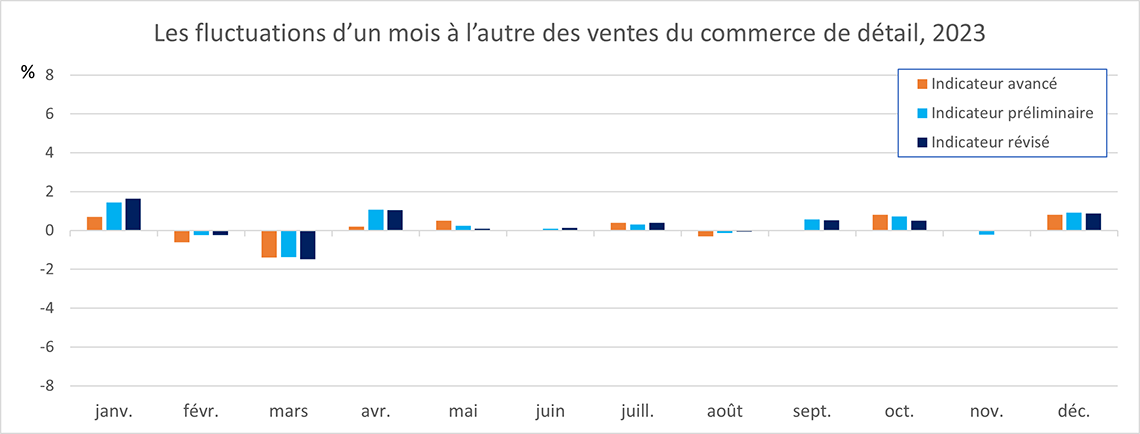Hé-coutez bien! Épisode 24 - Que faut-il faire pour sortir de l’itinérance? - Transcription
Transcription
ANNIK : Bienvenue à Hé coutez bien!, un balado de Statistique Canada, où nous rencontrons les personnes derrière les données et découvrons les histoires qu'elles révèlent. Je suis votre animatrice, Annik Lepage.
Nous faisons une promesse à chaque épisode : rencontrer les personnes qui se cachent derrière les données et explorer les histoires qui se cachent derrière les chiffres. Souvent, cela signifie rencontrer les personnes qui, à Statistique Canada, produisent et analysent les chiffres, mais cela signifie aussi aller plus loin, essayer de voir et de comprendre la personne qui se cache derrière chaque point de données afin qu'elle soit plus qu'une statistique.
SYLVIE : Il n'y a personne qui demande d'être à la rue. Puis, peut-être s'informer un peu plus à ce niveau-là, puis essayer de comprendre le pourquoi et d'avoir une nouvelle vision des gens qui sont là.
Fréquemment, on pense que les personnes ont des problèmes de toxicomanie. Nous, on l'a vu fréquemment chez nous, où est ce que les gens, arrivent chez nous, ils ont eu une malchance, euh, ils ont perdu leur emploi, ils sont plus capables d'arriver dans leur finance. Ils ne sont pas toxicomanes, ils n'ont pas de problème de dépendance, mais vivre à la rue peut développer ce genre de choses-là, donc avant d'y arriver là, c'est ça que j'aimerais que les gens pensent, vraiment mettre de côté les préjugés qu'on peut y avoir.
SYLVIE : Je suis Sylvie Corbin, directrice de la philanthropie ici à la Mission d'Ottawa et aussi porte-parole du côté francophone.
ANNIK : Pouvez-vous nous parler un peu de la Mission d'Ottawa?
SYLVIE: Oui, on pourrait passer une bonne heure à parler de la Mission. On a environ 250 lits, afin de loger les gens qui n'ont pas d'abri le soir. On offre le service de repas les gens qui habitent avec nous et aussi les gens de la communauté, donc, on a vraiment agrandi notre service de repas. Pendant la pandémie, on s'est vu offert un camion de restauration et notre camion qui avait débuté avec cinq communautés par le passé pour notre camion de restauration et maintenant on en fait 38 par semaine et, au-delà de 10 000 repas par semaine juste par le camion et en tout et partout notre service de repas dépasse les un million annuellement.
Donc, on offre au-dessus d'un million de repas, puis ça, c'est un chiffre qui a vu une croissance fulgurante, après la pandémie, je crois que les repas étaient environ un demi-million, donc on parle d'une croissance énorme, et ça prouve qu'il y a énormément de besoins ici dans la communauté.
Et puis, à la Mission aussi nous offrons au-dessus de 17 programmes, des programmes que ce soit en santé mentale, recherche de logement, éducation, on a une enseignante qui permet aux gens qui n'ont jamais complété leurs études secondaires, de le faire. On donne aussi énormément de soins de santé.
On a une clinique pour les gens qui en ont besoin. On a aussi un hospice de 20 lits pour les gens qui sont vulnérables ou qui n'ont pas d'endroit où habiter.
Donc, ça peut être en fin de vie ou un soin de répit suite à une intervention médicale. On était les premiers en Amérique du Nord, sinon, au monde, à avoir ce genre de choses-là dans un refuge pour sans-abri.
ANNIK : Alors d'après votre expérience, lorsqu'une personne réussit à sortir d'une situation d'itinérance, quels sont les principaux facteurs qui l'aident à faire cette transition?
SYLVIE : Ouais, c'est un soutien. Le facteur premier, c'est de vraiment voir quels sont les besoins. Donc, ils rentrent, ici, puis on leur demande, est-ce que vous avez déjà, regardé toutes les possibilités au niveau du logement? On les aide à faire une recherche pour le logement. Mais un autre facteur qui est très, très important, c'est la recherche, trouver un emploi qui puisse subvenir à leurs besoins. Une des solutions, c'est l'éducation. On a un programme de formation en service culinaire, on accueille des gens ici, ils ont une formation de 4 mois qui leur permettent d'aller travailler dans une cuisine commerciale, que ce soit un restaurant, que ce soit un foyer pour personnes retraitées, les hôpitaux et tout, donc, nos diplômés du programme, à 90 % se trouvent un emploi à leur passage chez nous.
ANNIK : Qu'est-ce qui aide une personne à passer du statut de sans-abri à celui de personne logée?
ANNIK : StatCan vient de publier une nouvelle étude basée sur les données de l'Enquête canadienne sur le logement qui explore précisément cette question, en demandant quels sont les facteurs spécifiques qui permettent le plus souvent de retrouver et de conserver un logement.
JEAN-PHILIPPE : Donc, on a mené un projet de recherche au cours des derniers mois afin de développer des nouvelles connaissances sur l'itinérance. Donc c'est un phénomène qui est très présent au Canada, puis qui amène à beaucoup de questions. Nos utilisateurs à Statistique Canada nous approchent fréquemment afin de mieux comprendre l'enjeu, les facteurs sous-jacents, puis les conséquences de l'itinérance.
Donc, dans le cadre de l'Enquête canadienne sur le logement, le troisième cycle de cette enquête-là, on a ajouté du nouveau contenu où on demande aux gens comment est-ce qu'ils ont réussi à se sortir de l'itinérance pour ceux qui ont eu cette expérience.
ANNIK : Pourriez-vous vous présenter avec votre nom et votre fonction?
JEAN-PHILIPPE : Bien sûr. Jean-Philippe Deschamps-Laporte. Je suis directeur adjoint dans la division responsable des questions de revenus et de logements à Statistique Canada.
ANNIK : Le mot itinérance recouvre en fait un ensemble d'expériences très diverses. Pourriez-vous nous parler de cela et des différentes façons dont une personne peut se trouver en situation d'itinérance?
JEAN-PHILIPPE : Certainement. Donc, il y a un type d'itinérance qu'on appelle hors refuge. Donc, hors refuge, ça fait référence aux personnes qui vivent dans des endroits qui sont normalement non habitables. Donc ça pourrait être dans la rue, dans un bâtiment désaffecté. Donc dans un lieu qui n'est normalement pas associé à l'habitation humaine. On a un autre type d'itinérance donc l'itinérance dans un refuge, Donc c'est des gens qui peuvent être dans un refuge pour personnes en itinérance de type standard si on veut. Il y a aussi des zones de refoulement. Donc, par exemple, actuellement, dans plusieurs parties du Canada, on fait face à une période de froid intense. Et puis très fréquemment, les municipalités mettent en place des infrastructures temporaires pour loger les personnes en situation d'itinérance
Puis on a également l'itinérance cachée. Donc une personne pourrait vivre de manière temporaire chez d'autres avec pas nécessairement une entente de type un bail locatif, puis l'aspect temporaire et l'aspect t possiblement instable caractérise ce type d'itinérance.
ANNIK : Quels sont les défis à relever pour obtenir une image précise de la population en situation d'itinérance au Canada?
JEAN-PHILIPPE : Donc, les défis sont à la fois opérationnels que éthiques. Donc, lorsqu'on parle de personnes en situation d'itinérance, on fait appel à la notion de vulnérabilité. Des personnes qui peuvent être dans une situation pour une multitude de raisons, ou peut être que répondre à une enquête statistique ce n'est pas nécessairement une priorité ou que simplement ils ont besoin d'un support social financier, de logement, qui prévaut sur le fait de répondre à une enquête statistique. Donc ça, c'est l'aspect, si on veut dire plus éthique, de dire toute personne a un temps fini dans une journée, puis lorsqu'on est particulièrement vulnérable, on doit se questionner est-ce qu'on doit retirer ce temps-là dans la journée d'une personne qui est dans cette situation-là?
Au niveau opérationnel, ce n'est pas simple de se dire on va récolter l'information sur l'ensemble des gens qui sont hors refuge, en refuge puis en itinérance cachée. Cela dit, on a des méthodes au Canada qui sont en place pour comprendre ces différents phénomènes, mais je ne vous cacherai pas, Annik, qu'il y a des enjeux. Donc une des méthodes qu'on utilise, comme dans l'Enquête canadienne sur le logement, c'est la méthode rétrospective. Donc on demande aux gens qui sont logés sur leurs expériences passées
On a aussi la voie des données administratives. La plupart des gens au Canada ont des interactions avec les services, que ce soit sociaux, que ce soit fiscaux.
Par exemple, une personne en itinérance, souvent une des premières choses lorsqu'elle va recevoir des services, c'est que les services sociaux vont l'aider à faire une déclaration fiscale parce que souvent, les gens ont droit à des bénéfices qu'ils ne reçoivent pas lorsqu'ils sont en situation d'itinérance.
Donc nous, avec nos partenaires, avec nos fournisseurs de données, mais par moments, on a l'opportunité d'utiliser à bon escient ces informations administratives afin de décrire les expériences d'itinérance pour cette population. Également, on a des enquêtes qui existent au Canada, pas menées par Statistique Canada, menées par nos partenaires à l'ICC avec leurs partenaires municipaux de dénombrement ponctuels de personnes en situation d'itinérance. Donc, il y a une multitude de méthodes pour arriver à différentes fins.
ANNIK : Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui ne sont pas actuellement en situation d'itinérance et mais qui ont pu en faire l'expérience au cours de leur vie?
JEAN-PHILIPPE : Oui, tout à fait. Donc les plus récents résultats de l'ECL, donc l'Enquête canadienne sur le logement, je vais référer à l'acronyme à partir de ce moment, révèle qu'une personne sur huit ont connu une situation d'itinérance sous une forme ou une autre par le passé. Donc, ce qui constitue 12 % des ménages avaient une personne qui ont pu avoir cette expérience par le passé.
Donc de ce 12 % là, eh bien, 2,6% ont connu un épisode d'itinérance en ou hors refuge et 11,2 % d'itinérance cachée. Donc on voit que l'itinérance cachée dans l'ensemble, au niveau des données récoltées dans l'ECL est plus fréquente que celles en ou hors refuge mais il y a aussi une combinaison c'est pour ça que ces chiffres-là s'additionnent pas sur le chiffre que je vous ai donné précédemment parce que c'est complexe, c'est selon des épisodes, on peut avoir les deux donc c'est ce qui explique ça. Mais de manière générale, on peut comprendre des résultats qu'il est plus fréquent d'avoir des expériences d'itinérance cachées que celle en ou hors refuge.
ANNIK : Le nombre de personnes en situation d'itinérance est important, selon Sylvie.
SYLVIE : Depuis 2018, l'itinérance a augmenté de 20% ici au Canada, donc c'est un chiffre énorme, on le voit à même nos yeux lorsqu'on se promène dans nos rues, dans nos villes et tout.
Un autre facteur qui est très important, c'est l'insécurité alimentaire. Nos collègues à la Banque Alimentaire d'Ottawa, leur dernier rapport, parlait d'une personne sur quatre, donc 25 percent des citoyens d'Ottawa sont en situation d'insuffisance au niveau de leur nourriture à toutes les semaines. Puis, souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens vont sauter un repas, deux repas, pour être capable de se payer le loyer.
Ce qu'on a vu le plus, c'est que notre refuge est plein à 100 %, depuis plus de 4 ans. Même on dit 110 % parce qu'on a des lits d'urgence qu'on doit mettre au sol et tout. On a une trentaine de personnes qui dorment assis dans notre salle d'attente, c'est du jamais vu.
ANNIK : En termes de démographie, que savons-nous des personnes sans domicile? Quelles sont les populations surreprésentées?
JEAN-PHILIPPE : Très bonne question. Merci, Annik. À ce niveau, il y a certains groupes de populations qui sont plus appelés à avoir eu cette expérience au cours de leur vie. Donc, en premier lieu, on parle des personnes autochtones. Donc, un ménage autochtone sur quatre a connu une expérience d'itinérance au cours de sa vie sous une forme ou une autre. On va se le dire, à 27,3 % des ménages autochtones c'est très important. Donc ce serait 8% des ménages autochtones qui ont connu l'itinérance en ou hors refuge, donc une forme plus profonde que celle cachée, ce qui est une proportion bien supérieure à celle de la population générale de 2,6%.
Donc ça, c'est un exemple où un groupe est particulièrement représenté. On a aussi les personnes 2ELGBTQ+, un ménage sur quatre contient des personnes qui ont eu une expérience d'itinérance, donc 24 % et ainsi que les anciens combattants à 16,8%. Donc, il y a certains groupes qui y sont plus appelés à être représentés à ce niveau-là.
Au niveau géographique, on a certains endroits également, où la prévalence de ces expériences est un peu plus forte que la part de la population au sein des 10 provinces qui sont échantillonnées dans l'ECL. Donc la Colombie-Britannique et les provinces des prairies ont des proportions légèrement supérieures en termes d'expérience d'itinérance.
ANNIK : L'Enquête canadienne sur le logement de 2022 a demandé aux ménages ayant vécu une expérience d'exclusion liée au logement, quels étaient les facteurs qui les avaient aidés à retrouver et à conserver un logement.
Qu'avons-nous appris en commençant peut être par le facteur le plus souvent cité?
JEAN-PHILIPPE : Donc c'est vraiment le cœur de l'article qu'on a publié récemment. Parce qu'auparavant on pouvait expliquer les entrées en itinérance, mais on ne s'était jamais attardé sur la sortie.
C'est une excellente question parce que cette information était préalablement, pas disponible. Donc, comme j'en faisais état précédemment, il y a une multitude de considérations qui peuvent expliquer une situation d'itinérance. Un peu du même souffle, Il y a une multitude de facteurs qui peuvent expliquer les sorties. Donc, parmi ces multiples facteurs, les données révèlent que les éléments financiers dominent. Je fais un petit aparté des données spécifiques de l'enquête et je me permets de commenter les perceptions qui peuvent exister sur les causes.
Donc, l'itinérance a tendance à être davantage visible. Et il y a toutes sortes de problèmes de société qui peuvent être en place. On pense à certaines crises de santé mentale sur les opioïdes par exemple. Les données de l'enquête suggèrent une interprétation différente que l'itinérance. La sortie d'itinérance est intimement associée avec les questions financières donc ce que ça pourrait suggérer puis encore là, je m'étale un peu au-delà des résultats spécifiques, c'est qu'une personne qui vivait avec un revenu fixe disons en 2020 avant la pandémie qui, en Ontario, pouvait être récipiendaire de bénéfices pour un handicap, dans une autre province, pouvait avoir des bénéfices d'aide sociale, mais ces bénéfices-là ont tendance à augmenter légèrement à travers le temps, mais on est dans un marché locatif ou les prix ont augmenté rapidement. Donc, il est possible que les données qu'on voit dans l'ECL qui disent que les gens qui ont trouvé un emploi, ont augmenté leurs revenus, ont trouvé une solution financière bien, il est possible qu'il y ait une association avec ce qu'on peut voir dans la société qu'il y a des gens qui pouvaient avoir de la difficulté avant la pandémie avant les hausses marquées dans le marché locatif, mais qui étaient capables de se payer un loyer et que là les gens qui ont été capables de s'en sortir si c'est une question financière, ça retourne aux dynamiques de logement. Donc, c'est un point là que j'aimerais partager dans ma conversation avec vous, Annik, c'est l'importance des éléments financiers.
ANNIK : L'accession à la propriété est le rêve de nombreux Canadiens. Parmi les personnes qui ont vécu en situation d'itinérance par le passé, comment ont-ils réussi à accéder à la propriété? Quels sont les facteurs susceptibles d'influencer ce résultat?
JEAN-PHILIPPE : Donc, l'accession à la propriété résidentielle, c'est la forme ultime d'accumulation d'actifs. Donc pour les Canadiens, posséder leur maison, c'est souvent le plus grand actif et souvent le plus grand passif. Pour y accéder, bien, on doit économiser pour avoir une mise de fonds, puis on doit avoir un revenu pour payer les paiements. Dans un contexte où une personne a vécu en situation d'itinérance ça veut souvent dire que cette personne-là a pu épuiser ses actifs financiers lorsqu'elle s'est retrouvée dans cette situation-là. Puis nos résultats suggèrent que même 10 ans après les expériences d'itinérance, le taux d'accession à la propriété pour les personnes qui ont eu ces expériences est beaucoup plus bas que pour le reste de la population, ce qui est totalement cohérent avec cette histoire d'actif qu'aujourd'hui avec les prix du logement dans les grandes villes canadiennes et même les plus petites villes canadiennes, ça prend du temps pour accumuler une mise de fonds. Donc, si on a eu des expériences qui a fait en sorte qu'on n'avait plus rien, c'est logique d'avoir plus de difficulté d'accéder à la propriété ultérieurement.
ANNIK : Et les personnes qui, avec le temps, ont réussi à trouver un logement sont-elles susceptibles de continuer à être confrontés à des problèmes de logement?
JEAN-PHILIPPE : Oui, tout à fait. Donc on a différentes mesures au Canada afin de décrire les enjeux ou les problèmes de logement auxquels les ménages font face. Ça peut être au niveau de l'abordabilité, ça peut être en raison du manque d'espace. Donc un nombre trop élevé de personnes par chambre à coucher ou ça peut être en lien avec la qualité, donc de demeurer dans un logement qui a besoin de réparations majeures. Donc, lorsqu'on regarde ces indicateurs-là, les personnes qui ont réussi à fuir l'itinérance ont davantage tendance à faire face à des problèmes de logement sous les trois indicateurs que j'ai mentionnés, même lorsque ces itinérances-là sont distancées par le passé, ce qui suggère peut-être des enjeux à long terme au niveau financier ou ce qui suggère peut-être aussi de dire afin de sortir d'itinérance, je dois être dans un appartement trop petit, donc d'avoir, par exemple, les enfants qui dorment dans la même chambre que les parents, des genres de solution auxquels les gens arrivent afin d'éviter d'être en itinérance. Ou les logements qui sont abordables ou non, qui sont inabordables mais qui demeurent accessibles. D'une certaine manière, au point de vue financier, ce sont ceux de piètre qualité, donc des logements qui pourraient avoir des moisissures qui pourraient avoir des écoulements d'eau, c'est ceux qui coûteraient le moins cher puis qui seraient les seuls qui seraient accessibles pour les personnes qui ont eu des situations d'itinérance et qui pourraient demeurer dans une certaine forme de vulnérabilité.
ANNIK : Pouvez-vous parler de l'impact à long terme de l'itinérance sur le bien-être, en d'autres termes, quel effet l'expérience d'itinérance a-t-elle sur le bien-être, même après que même après qu'une personne ait trouvé un logement?
JEAN-PHILIPPE : Donc, sans surprise, compte tenu des éléments que je partageais à l'instant, les personnes qui ont réussi à fuir l'itinérance démontrent une qualité de vie, subjective, on s'entend, moindre que les personnes qui n'ont pas eu ces expériences. Puis ça, ça demeure, même lorsque ça a fait 10 ans que les expériences sont passées. C'est difficile à dire si c'est directement lié à l'expérience d'itinérance comme tel ou aux facteurs qui ont expliqué l'épisode en tant que tel. Donc, on voit que même après, les personnes qui ont eu ces expériences-là ont une qualité de qualité de vie moindre que celles qui n'ont pas eu ces expériences-là.
ANNIK : Et de quelle manière l'itinérance laisse-t-elle un impact durable sur les personnes qui en font l'expérience?
SYLVIE : Il y a plusieurs impacts, on parle des impacts de santé, c'est des impacts sérieux. On parle d'une espérance de vie diminuée de façon substantielle. Dans la population générale, un homme peut vivre jusqu'à 79 ans. Une personne qui se trouve en situation, un homme en situation d'itinérance, c'est 55 ans. Donc, l'espérance de vie est diminuée de façon importante. Chez les femmes, l'espérance de vie normale de 84 ans chez les femmes, celle en situation d'itinérance, 48 ans.
Donc, c'est des chiffres ahurissants quand on les entend, c'est sûr qu'en souffrance, il y a toutes sortes de raisons, l'insécurité alimentaire est une des premières raisons. Souvent ils vont être susceptibles d'avoir des maladies comme l'hépatite C, aussi des maladies cardiaques, cancers, asthmes, ce sont tous des maladies qui sont plus prononcées chez ces populations-là. Et puis ils ont la santé plus fragile, donc, il y a un impact important sur tous les autres services. Donc, si on adressait la situation de l'itinérance comme telle, il y aurait même moins d'impact sur les services sociaux, moins d'impact sur les services de santé. Donc, il découle beaucoup de choses lorsqu'on laisse nos voisins, si je peux dire, en situation, précaire quand ils n'ont pas de logement finalement.
ANNIK : Si on veut en savoir plus sur votre travail ou devrait-on aller?
JEAN-PHILIPPE : J'invite les auditeurs à aller sur la page web de Statistique Canada, on a un portail sur le logement où les données de l'ECL sont accessibles ainsi qu'une panoplie d'informations sur le logement. Parce que l'itinérance qui est le sujet d'aujourd'hui, ça n'évolue pas en vase clos, il y a tout un contexte, tout un système de logement qui influence de toutes sortes de manières positives et adverses également cet enjeu-là spécifique. Donc, j'invite les auditeurs à visiter notre page, notre portail sur le logement où on a la chance de développer des connaissances uniques pour informer cet enjeu de société.
ANNIK : Merci beaucoup, Jean-Philippe.
JEAN-PHILIPPE : De rien. Merci.
ANNIK : Sylvie, si on voudrait en savoir plus sur votre travail où peut-on aller?
SYLVIE : C'est, ottawamission.com. Donc, ottawamission.com et puis on parle beaucoup de nos programmes et des services offerts à la communauté qui en ont le besoin.
ANNIK : Merci. Merci pour votre temps, Sylvie.
SYLVIE : Annik, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de vous informer un peu plus et nous donner cette plateforme afin de parler de notre travail.
ANNIK : Merci d'avoir écouté Hé-coutez bien! Un gros merci à nos invités, Sylvie Corbin et Jean-Philippe Deschamps-Laporte. Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez un lien vers l'étude de StatCan sur l'itinérance dans les notes de cette émission. Vous pouvez écouter cette émission partout où vous écoutez vos balados. Vous y trouverez également la version anglaise de notre émission, intitulée Eh Sayers. Si vous avez aimez cette émission n'hésitez surtout pas à la noter, à la commenter et à vous y abonner et merci de nous avoir écouté.